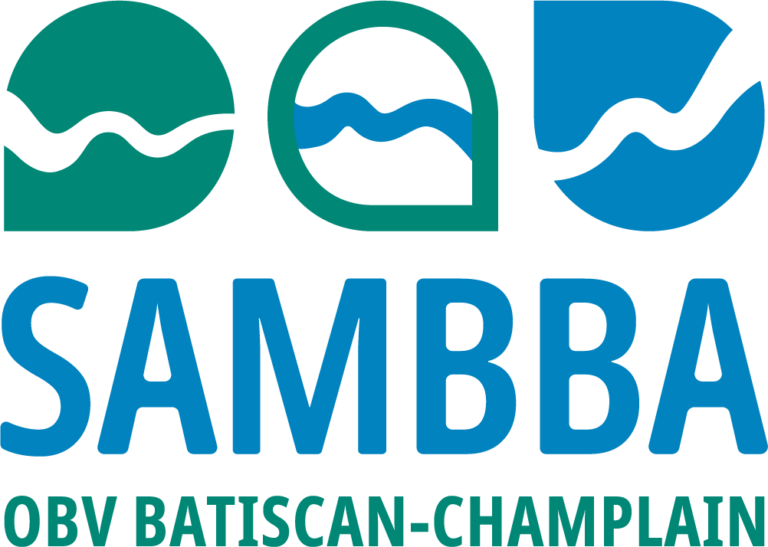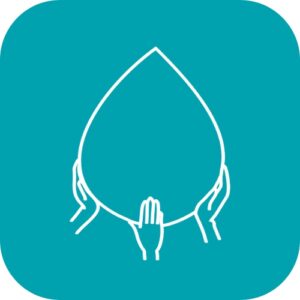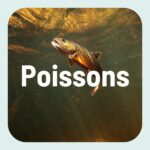Associations de lac
Dans cette page
Comprendre
Avant de poser des gestes concrets pour protéger un lac, il est essentiel de bien en comprendre le fonctionnement. Qu’est-ce qu’un bassin versant ? Quel rôle jouent les milieux humides, les bandes riveraines ou encore les habitats fauniques ? Quels sont les effets des apports en nutriments, des embarcations ou des espèces exotiques envahissantes ?
Cette section vous propose un aperçu clair et vulgarisé des principaux éléments qui influencent la santé des lacs. À travers des outils visuels, des ressources fiables et des liens vers des chroniques éducatives, vous aurez en main les clés pour décoder les enjeux, repérer les signes de déséquilibre… et poser des actions éclairées.
Chroniques sur l'eau
Les chroniques sur l’eau permettent de mieux comprendre l’eau, ses habitants et ses phénomènes dans la zone de gestion intégrée de l’eau Batiscan-Champlain. Cliquez sur le sujet qui vous intéresse, ou découvrez toutes les chroniques de la SAMBBA ici.
Boîte à outils
Les enjeux des lacs
Eutrophisation
Algues bleu-vert (cyanobactéries)
 Le nom scientifique de ces organismes microscopiques est « cyanobactéries ». L’appellation « bleu-vert » vient des pigments bleus et verts dominants chez la plupart des espèces. Certaines affichent des couleurs différentes, comme du rouge ou du brun, mais nous les observons moins souvent.
Le nom scientifique de ces organismes microscopiques est « cyanobactéries ». L’appellation « bleu-vert » vient des pigments bleus et verts dominants chez la plupart des espèces. Certaines affichent des couleurs différentes, comme du rouge ou du brun, mais nous les observons moins souvent.- Les algues bleu-vert sont naturellement présentes dans les lacs et les rivières du Québec à de faibles densités. Elles posent problème quand elles se multiplient trop et forment des « fleurs d’eau ».
- Les fleurs d’eau d’algues bleu-vert peuvent présenter un risque pour la santé. Par exemple, une personne peut présenter des symptômes de gastro-entérite ou ressentir une irritation de la peau ou de la gorge après avoir bu de l’eau provenant d’une fleur d’eau d’algues bleu-vert ou après être entrée en contact avec celle-ci.
- En savoir plus.
Espèces exotiques envahissantes (EEE)
 Ce sont des plantes, animaux, algues et micro-organismes d'eau douce ou marins, introduits en dehors de leur aire de répartition naturelle ou passée.
Ce sont des plantes, animaux, algues et micro-organismes d'eau douce ou marins, introduits en dehors de leur aire de répartition naturelle ou passée.- Ils ont des effets négatifs importants sur l'environnement, l'économie, la société et la santé humaine.
- Une fois introduite, une population d'espèces aquatiques envahissantes peut croître rapidement, car aucun prédateur naturel n'existe dans leur nouvel environnement.
- Les EEE constituent l'une des 6 problématiques priorisées par les utilisateurs de l'eau en 2023 pour le plan directeur de l'eau de la zone Batiscan-Champlain.
- En savoir plus.
Impact des pratiques humaines
- Effluents industriels et municipaux ;
- Eaux de ruissellement des terres agricoles ;
- Débordements d'égouts ;
- Rejets d'eaux usées ;
- Installations septiques ;
- Animaux domestiques ;
- Épandage de sels déglaçant ;
- Rejets industriels, l'exploitation minière ou les sites d'enfouissement ;
- Etc.
Liens utiles
- L’Atlas de l’eau est une carte interactive qui permet de consulter de façon simultanée les différentes connaissances sur l’eau. Elle est mise à jour périodiquement pour permettre l’ajout de nouvelles informations et pour actualiser les connaissances disponibles, qui sont en constante évolution. Les informations présentées concernent, notamment, les sources de pollution du milieu aquatique, la qualité de l’eau et des écosystèmes ainsi que les problématiques prioritaires identifiées par zone de gestion intégrée de l’eau par bassin versant.
- Le répertoire des plantes aquatiques sur le site internet de la SAMBBA est mis à jour au fils des inventaires réalisés dans les lacs et cours d’eau de la ZGIEBV Batiscan-Champlain. Il est possible de faire des recherches par lacs inventoriés et par type de plantes aquatiques.
Unir
Face aux nombreux défis qui menacent la santé des lacs, l’action collective devient une force incontournable. Former ou joindre une association de riverains, c’est choisir de ne plus agir seul, mais de s’unir autour d’un objectif commun : la protection de notre milieu de vie.
Cette section vous présente tous les avantages de créer ou de rejoindre une association.
Les avantages à former une association de lac
Agir ensemble pour protéger le milieu naturel. Une volonté collective permet d’avoir plus d’impact qu’en agissant seul.
Trouver des solutions concrètes. En partageant objectifs, connaissances et ressources, on peut résoudre des problèmes locaux plus efficacement.
Gagner en crédibilité. Un groupe organisé devient un interlocuteur légitime auprès des municipalités, ministères et entreprises.
Sensibiliser et mobiliser d’autres riverains. En créant une tribune, on peut informer et engager la communauté.
Accéder à des ressources et des subventions. Les regroupements facilitent l’accès à du financement, des services communs et à des programmes comme le RSVL.
Comment former une association de riverains ?
Une association est un groupe plus ou moins organisé de personnes qui s’unissent volontairement dans un but déterminé, en vertu des lois et dans les limites du droit d’association reconnu par les chartes.
Dans ce contexte, une association de protection de l’environnement d’un lac est un groupe de personnes ayant en commun l’intérêt de protéger la qualité de l’eau, des paysages et des usages d’un lac et de son bassin versant.
Lors de la formation de l’association, il est souhaitable d’inviter la municipalité à collaborer à la démarche, soit par l’entremise du maire, de l’urbaniste ou de l’inspecteur. On peut aussi faire appel à l’expertise de l’organisme de bassin versant de la région.
Sources : CRE Laurentides, OBV Bas Saint-Laurent.
Les formes juridiques d’associations
Les informations présentées proviennent d’un document datant de 2015. Il est donc possible que certaines données ne soient plus à jour. Il vous revient de vérifier leur exactitude et de compléter la recherche au besoin.
Deux formes juridiques sont possibles lorsque vient le temps de former officiellement l’association :
- Association non personnifiée (non dotée de la personnalité morale)
- Structure peu complexe, ayant peu de membres et peu de biens à administrer.
- Les règles de fonctionnement sont prévues par le Code civil du Québec.
- Les administrateurs sont personnellement responsables des obligations de l’association qui résultent des décisions auxquelles ils ont consenti durant leur administration.
- Association personnifiée (dotée de la personnalité morale sans but lucratif)
- Les membres de la corporation ne sont pas personnellement responsables des dettes et des engagements de la corporation; ils ne sont tenus responsables que du paiement de leur cotisation.
- La corporation peut faire ou recevoir des dons.
- Les administrateurs de la corporation ne sont pas personnellement responsables envers les tiers.
- La corporation peut poursuivre ou être poursuivie devant les tribunaux. Cette dernière forme juridique est la plus adaptée pour les associations de lacs. Par exemple, plusieurs subventionnaires requièrent que leurs bénéficiaires soient constitués en corporation. Cependant, l’administration de la corporation est plus complexe, notamment en raison de l’obligation d’accomplir certaines formalités comme la rédaction des procès-verbaux des assemblées de membres et des réunions du conseil d’administration.
Le rôle du conseil d’administration (C.A.)
Le C.A. est l’organe par lequel l’association agit. Deux missions lui sont assignées : d’une part, gérer l’association (rôle interne) et d’autre part, la représenter vis-à-vis des tiers (rôle externe). Le C.A. est composé d’administrateurs élus.
Le C.A. veille, entre autres, à :
- Appliquer les règlements généraux;
- Représenter les riverains et leurs intérêts;
- Exécuter les décisions prises lors de l’assemblée générale annuelle (AGA);
- Préparer et soumettre les objectifs, le plan d’action annuel et les prévisions budgétaires pour approbation à l’AGA;
- Préparer les affaires de l’association et voir à la préparation et à la mise à jour des documents touchant notamment la tenue de livres, les activités sociales, les procédures d’assemblée.
Les associations de lac de la zone Batiscan-Champlain
Si votre association ne se retrouve pas ci-dessous, veuillez nous en aviser par courriel. Merci !
Hérouxville
Association | Coordonnées | Actions réalisées |
Association pour la protection du Lac-à-la-Tortue (APL) | 2021 – Plan directeur de lac : https://www.shawinigan.ca/wp-content/uploads/2022/01/210712_PDE_lacalatortue.pdf |
Lac-aux-Sables
| Association | Coordonnées | Actions réalisées |
| Association des Résidents pour la protection du lac aux Sables (ARPLAS) | https://www.arplas.org/ | Le réseau de surveillance volontaire des lacs |
| Association des propriétaires riverains du lac Veillette (APLV) | Le réseau de surveillance volontaire des lacs | |
| Association des propriétaires riverains du lac Huron (ARLH) | Le réseau de surveillance volontaire des lacs | |
| Association des résidents du lac Trois-Milles | Le réseau de surveillance volontaire des lacs | |
| Association des propriétaires du lac Georges | https://aplg.neocities.org/ | Le réseau de surveillance volontaire des lacs |
Lac-Édouard
Association | Coordonnées | Actions réalisées |
Association du développement écologique du lac Édouard (ADÈLE) |
Notre-Dame-de-Montauban
Association | Coordonnées | Actions réalisées |
Association des propriétaires du lac Georges (APLG) | Le réseau de surveillance volontaire des lacs | |
Association des résidents du lac Trois-Milles (ARLTM) | http://arltm.org/ | Le réseau de surveillance volontaire des lacs |
Sainte-Thècle
Association | Coordonnées | Actions réalisées |
Association des riverains pour la protection du lac Croche de Sainte-Thècle (ARPLC) | 2010 - État trophique et qualité de l’eau: https://www.arplc.ca/wp-content/uploads/2013/03/EtudeLacCroche2010SAMBBA.pdf | |
Association des propriétaires de chalets du lac du Jésuite (APCLJ) | 2025 – Guide plaisanciers, Guide sécurité nautique, La vie sur l'eau : https://ste-thecle.qc.ca/environnement-et-milieu-riverain/notre-milieu-riverain/acces-aux-plans-deau/ | |
Association des propriétaires du Domaine-le Jeune |
Saint-Maurice
Association | Coordonnées | Actions réalisées |
Association du lac Montreuil |
|
Saint-Tite
Association | Coordonnées | Actions réalisées |
Association des propriétaires du lac Pierre-Paul (APLPP) | 2025 - Promouvoir l'installation d'une station publique de lavage des embarcations auprès de la Ville de Saint-Tite. 2025 - Promouvoir la vérification de la conformité des installations septiques individuelles des résidences du lac Pierre-Paul (Saint-Tite) auprès de la municipalité. 2025 - Tenir une rencontre de concertation incluant les trois associations de lac de Saint-Tite pour mettre en commun les défis similaires (lac Trottier, Pierre-Paul, à la Perchaude). | |
Association des propriétaires du lac Perchaude inc. | 2025 - Accompagnement des propriétaires riverains du lac à la Perchaude dans l'aménagement de bandes riveraines. 2025 - Installer trois pancartes faisant la promotion du lavage des embarcations nautiques à proximité du lac à la Perchaude. 2025 - Tenir une rencontre de concertation incluant les trois associations de lac de Saint-Tite pour mettre en commun les défis similaires (lac Trottier, Pierre-Paul, à la Perchaude). | |
Association de protection du lac Trottier | Sensibiliser les propriétaires riverains du lac Trottier sur l'impact des systèmes sanitaires unitaires pour éviter les conflits d'usages. 2025 - Tenir une rencontre de concertation incluant les trois associations de lac de Saint-Tite pour mettre en commun les défis similaires (lac Trottier, Pierre-Paul, à la Perchaude). |
Shawinigan (secteur Lac-à-la-Tortue)
Association | Coordonnées | Actions réalisées |
Association pour la protection du Lac-à-la-Tortue (APL) | 2021 – Plan directeur de lac : https://www.shawinigan.ca/wp-content/uploads/2022/01/210712_PDE_lacalatortue.pdf |
Une action à partager ?
Partagez-nous l’action réalisée par votre association pour bonifier la liste.
Agir
En tant qu’acteurs de l’eau, vous êtes en première ligne pour détecter les signes de dégradation des plans d’eau et mettre en place des solutions concrètes. Qu’il s’agisse de prévenir la propagation des espèces exotiques envahissantes, de participer à un programme de suivi volontaire, de sensibiliser vos membres ou de poser des gestes simples mais efficaces sur le terrain, chaque action compte.
Cette section vous propose des outils, des protocoles et des services pour vous guider dans votre rôle de gardien du lac ainsi que plusieurs sources de financement pour vos projets.
Outils, protocoles et services
Suivre le stade d’eutrophisation d’un lac : Plusieurs suivis sont possibles, nécessitant plus ou moins de ressources financières et humaines, dépendamment de la question à laquelle vous souhaitez répondre. Il s’agit de, allant de moindre ressources à des ressources plus importantes :
Suivre le stade d'eutrophisation avec le périphyton
 La caractérisation et le suivi du périphyton présent dans le littoral des lacs sont des approches relativement récentes pour évaluer l’eutrophisation de ces derniers. L’intérêt pour cet indicateur vient du lien démontré entre l’abondance du périphyton et l’importance des apports en phosphore, notamment les apports liés à l’occupation humaine dans le bassin versant des lacs. Dans certains lacs, un changement dans le périphyton peut même être un des premiers signes observables de l’enrichissement par les matières nutritives. Le suivi du périphyton à l’aide d’un protocole rigoureux et standard devient donc intéressant pour établir la situation de cette composante et pour suivre son évolution dans le temps. Les résultats vont donner des indications sur l’eutrophisation du lac.
La caractérisation et le suivi du périphyton présent dans le littoral des lacs sont des approches relativement récentes pour évaluer l’eutrophisation de ces derniers. L’intérêt pour cet indicateur vient du lien démontré entre l’abondance du périphyton et l’importance des apports en phosphore, notamment les apports liés à l’occupation humaine dans le bassin versant des lacs. Dans certains lacs, un changement dans le périphyton peut même être un des premiers signes observables de l’enrichissement par les matières nutritives. Le suivi du périphyton à l’aide d’un protocole rigoureux et standard devient donc intéressant pour établir la situation de cette composante et pour suivre son évolution dans le temps. Les résultats vont donner des indications sur l’eutrophisation du lac.
Suivre le stade d'eutrophisation avec le Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL)
Les objectifs :
- Acquérir des données afin d’établir le niveau trophique d’un grand nombre de lacs et suivre leur évolution dans le temps;
- Dépister les lacs montrant des signes d'eutrophisation et de dégradation;
- Éduquer, sensibiliser, soutenir et informer les associations de riverains et les autres participants;
- Dresser un tableau général de la situation des lacs de villégiature au Québec.
- En savoir plus.
Délimiter et identifier les bancs de macrophytes
La présence de macrophytes est naturelle et importante. Ce qu’il faut noter, ce sont les changements observés dans les populations, tant dans la variation du nombre de plantes qu'au niveau de la diversité des espèces. Un changement dans l’abondance des plantes aquatiques sera l’un des paramètres utilisés pour mesurer l’eutrophisation d’un lac.
L’abondance des plantes aquatiques dans les zones peu profonde du lac (le littoral), l’accumulation de sédiments et l’enrichissement du lac en matières nutritives favorisent la croissance des plantes aquatiques. Il y a une augmentation de leur étendue et de leur densité avec le changement de niveau trophique. Les lacs eutrophes sont souvent caractérisés par une forte abondance de plantes aquatiques.
Diagnose : portrait de la santé écologique d'un lac
Une diagnose de lac est une étude détaillée qui permet de dresser un portrait global de l'écosystème d'un lac. Elle sert a évaluer la qualité de l'eau l'état des rives, la présence d'herbiers aquatiques, la population de poissons, l'état des tributaires et plus encore. Elle permet d'identifier les problèmes potentiels et établir des pistes de solutions.
Autres suivis possibles :
Suivre la qualité bactériologique de l'eau avec le programme Environnement-Plage
Chaque saison estivale, le Ministère invite les exploitants de plage à participer au programme Environnement-Plage. Grâce à ce partenariat, le Ministère et les participants au programme sont ainsi en mesure d’informer la population de la qualité bactériologique des eaux de baignade des plages participantes, pour permettre à la population de profiter de ces lieux.
Détecter et signaler les espèces exotiques envahissantes (EEE) avec Sentinelle

Sentinelle est un outil gratuit offert par le Gouvernement du Québec pour la détection et le signalement des EEE au Québec. Il permet aux citoyens de contribuer à la surveillance de ces espèces et de fournir des informations précieuses.
Après avoir navigué, pêché ou pratiqué une activité nautique ou aquatique, il faut prendre des précautions pour éviter de propager des EEE entre plans d’eau :
- Nettoyez tout ce qui a été en contact avec l’eau (remorque, embarcation, équipement) en retirant tous les organismes, les végétaux et les résidus de boue. Autant que possible, combinez ce nettoyage avec un lavage intérieur et extérieur à l’eau chaude pour assurer la mort des organismes (entre 40° C et 60° C).
- Videz toute l’eau de l’embarcation (cale, moteur, vivier, ballast) et de l’équipement (bottes, glacières, chaudières). Assurez-vous qu’elle ne s'écoule pas vers un autre plan d’eau.

- Séchez selon l’une des options suivantes :
- À l’air libre pendant au moins cinq jours avant de visiter un autre plan d’eau.
- Si ce délai n’est pas possible, essuyez soigneusement les différentes parties de l'embarcation, la remorque et les équipements avec des serviettes ou des chiffons.
- Si un lavage à l’eau chaude (entre 40° C et 60° C) a été fait, un séchage complet n’est pas nécessaire.
- En savoir plus sur le nettoyage d'embarcations.
Pour trouver une station de nettoyage, vous pouvez consulter l’Atlas de l’eau et le portail Forêt ouverte qui proposent des cartes interactives.
Détecter et signaler les algues bleu-vert (cyanobactéries)
Être un bon riverain
Les riverains sont les gardiens de nos précieux lacs et cours d'eau. Comme ils sont à l'affut de tous changements écosystémiques, il faut les outiller dans le but de préserver la qualité de notre eau. Ils peuvent agir dès maintenant afin de ralentir le vieillissement prématuré de nos lacs, ainsi que de contrôler les quantités d'apports en nutriments et les facteurs de prolifération d'espèces exotiques envahissantes.
Agir avec la SAMBBA
La SAMBBA peut vous accompagner dans le choix des suivis environnementaux à réaliser, en fonction de l’hypothèse que votre association souhaite valider.
- Services conseils SAMBBA (soutien technique, animation, diagnostics) :
- Sensibilisation, éducation;
- Bande riveraine (rive);
- Installations septiques;
- Gestion intégrée de l’eau;
- Milieux humides et naturels.
- En savoir plus.
Source de financement
Chaque geste compte pour préserver la santé de nos lacs, mais ensemble, nous pouvons aller encore plus loin. Que vous rêviez d’un projet de restauration, de suivi de la qualité de l’eau ou d’un aménagement durable, des outils et des appuis financiers sont là pour vous soutenir.
Le financement ne devrait jamais freiner votre élan : il peut devenir un tremplin. Voici des programmes concrets pour passer de l’idée à l’action — et transformer votre engagement en résultats durables.
La recherche a été effectuée en juillet 2025. Il appartient toutefois à chaque association de vérifier l’admissibilité aux programmes et la validité des informations selon son contexte.
Liste des programmes de financement du ROBVQ
La liste des programmes de financement du Réseau des organismes de bassin versant du Québec (ROBVQ) est mise à jour régulièrement.
Soutien financier pour les participants au Réseau de surveillance volontaire des lacs
Pour soutenir le suivi et la protection des lacs, le Ministère assume 75 % des frais prévus dans le cadre du RSVL. Dans le cas des nouvelles inscriptions au réseau, un montant additionnel de 75 $ est à prévoir pour acquérir un disque de Secchi permettant de mesurer la transparence de l’eau. Il n’y a aucuns frais pour les années où le participant effectue seulement le suivi de la transparence de l’eau.
Programme de soutien régional aux enjeux de l’eau (PSREE)
Issu du plan d’action 2018-2023 de la Stratégie québécoise de l’eau 2018-2030 (SQE 2018-2030), il vise à optimiser la gestion des ressources en eau et améliorer la protection des milieux hydriques et des écosystèmes aquatiques. Il soutient la réalisation d’actions inscrites dans les plans directeurs de l’eau (PDE) et les plans de gestion intégrée régionaux (PGIR), en lien avec les problématiques prioritaires des bassins versants.
Programme Affluents Maritime 2023-2025
Il offre un financement à des organismes pour la réalisation de projets favorisant le développement durable et la santé environnementale des affluents du Saint-Laurent. Ces derniers doivent contribuer directement à la protection des écosystèmes et de la biodiversité, ainsi qu’à la pérennité des ressources et des usages du Saint-Laurent et du Québec maritime.
Programmes d’aide financière relatifs aux zones inondables, aux zones de mobilité des cours d’eau, aux rives et au littoral
Plusieurs programmes de financement concernant les milieux hydriques, dont les zones inondables, et l’encadrement des ouvrages de protection contre les inondations sont disponibles. Ces programmes visent à assurer la sécurité de la population, à protéger les biens et à préserver l’environnement.
Fondation de la faune du Québec
Elle peut vous prêter main forte dans vos projets de conservation, d’aménagement ou de mise en valeur d’habitats fauniques avec un de ses programmes d’aide financière.
Programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques
Il vise à financer la réalisation d’études préalables et de projets de restauration et de création de milieux humides et hydriques fonctionnels et pérennes.
Programmes de financement pour les Initiatives relatives aux écosystèmes d’eau douce
Il soutien les projets qui amélioreront la qualité de l’eau et la santé écologique des plans d'eau d'importance nationale.
Programme Stations de nettoyage d'embarcations
Le programme Stations de nettoyage d'embarcations 2023-2028 contribue à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes aquatiques et les organismes pathogènes de la faune aquatique. Il encourage l’installation ou la réfection de stations de nettoyage d’embarcations.